Poésie
Page 1 sur 1

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Poésie
Poésie
Le Bateau Ivre
Comme je descendais des Fleuves impassibles,
Je ne me sentais plus tiré par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
J'étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands et de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.
La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots
Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l'oeil niais des falots !
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures,
L'eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend ;
Où, teignant tout à coup les bleuiés, délires
Et rythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l'amour !
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs et les courants : Je sais le soir,
L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes,
Et j'ai vu quelques fois ce que l'homme a cru voir !
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très-antiques
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets !
J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,
La circulation des sèves inouïes
Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs !
J'ai suivi, des mois pleins, pareilles aux vacheries
Hystériques, la houle à l'assaut des récifs,
Sans songer que les pieds lumineux des Maries
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs !
J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux des panthères à peaux
D'hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux !
J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan !
Des écroulement d'eau au milieu des bonaces,
Et les lointains vers les gouffres cataractant !
Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises !
Échouages hideux au fond des golfes bruns
Où les serpents géants dévorés de punaises
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums !
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.
- Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades
Et d'ineffables vents m'ont ailé par instant.
Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs d'ombres aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux...
Presque île, balottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabotteurs aux yeux blonds.
Et je voguais lorqu'à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir à reculons !
Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N'auraient pas repéché la carcasse ivre d'eau ;
Libre, fumant, monté de brumes violettes,
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des morves d'azur ;
Qui courais, taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient couler à coups de trique
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ;
Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l'Europe aux anciens parapets !
J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur :
- Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles,
Million d'oiseaux d'or, ô future vigueur ? -
Mais, vrai, j'ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer :
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes.
Ô que ma quille éclate ! Ô que j'aille à la mer !
Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé
Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leurs sillages aux porteurs de cotons,
Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.
Je ne me sentais plus tiré par les haleurs :
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.
J'étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands et de cotons anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages
Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Dans les clapotements furieux des marées,
Moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N'ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.
La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots
Qu'on appelle rouleurs éternels de victimes,
Dix nuits, sans regretter l'oeil niais des falots !
Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sures,
L'eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des vomissures
Me lava, dispersant gouvernail et grappin.
Et dès lors, je me suis baigné dans le Poème
De la Mer, infusé d'astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême
Et ravie, un noyé pensif parfois descend ;
Où, teignant tout à coup les bleuiés, délires
Et rythmes lents sous les rutilements du jour,
Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de l'amour !
Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes
Et les ressacs et les courants : Je sais le soir,
L'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes,
Et j'ai vu quelques fois ce que l'homme a cru voir !
J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très-antiques
Les flots roulant au loin leurs frissons de volets !
J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,
Baiser montant aux yeux des mers avec lenteurs,
La circulation des sèves inouïes
Et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs !
J'ai suivi, des mois pleins, pareilles aux vacheries
Hystériques, la houle à l'assaut des récifs,
Sans songer que les pieds lumineux des Maries
Pussent forcer le mufle aux Océans poussifs !
J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides
Mêlant aux fleurs des yeux des panthères à peaux
D'hommes ! Des arcs-en-ciel tendus comme des brides
Sous l'horizon des mers, à de glauques troupeaux !
J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan !
Des écroulement d'eau au milieu des bonaces,
Et les lointains vers les gouffres cataractant !
Glaciers, soleils d'argent, flots nacreux, cieux de braises !
Échouages hideux au fond des golfes bruns
Où les serpents géants dévorés de punaises
Choient, des arbres tordus, avec de noirs parfums !
J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants.
- Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades
Et d'ineffables vents m'ont ailé par instant.
Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,
La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs d'ombres aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu'une femme à genoux...
Presque île, balottant sur mes bords les querelles
Et les fientes d'oiseaux clabotteurs aux yeux blonds.
Et je voguais lorqu'à travers mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir à reculons !
Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses,
Jeté par l'ouragan dans l'éther sans oiseau,
Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses
N'auraient pas repéché la carcasse ivre d'eau ;
Libre, fumant, monté de brumes violettes,
Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des morves d'azur ;
Qui courais, taché de lunules électriques,
Planche folle, escorté des hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient couler à coups de trique
Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs ;
Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités bleues,
Je regrette l'Europe aux anciens parapets !
J'ai vu des archipels sidéraux ! et des îles
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur :
- Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles,
Million d'oiseaux d'or, ô future vigueur ? -
Mais, vrai, j'ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer :
L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes.
Ô que ma quille éclate ! Ô que j'aille à la mer !
Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé
Un enfant accroupi plein de tristesses, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames,
Enlever leurs sillages aux porteurs de cotons,
Ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons.

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Poésie
Poésie
Les passantes
Je veux dédier ce poème
A toutes les femmes qu'on aime
Pendant quelques instants secrets
A celles qu'on connaît à peine
Qu'un destin différent entraîne
Et qu'on ne retrouve jamais
A celle qu'on voit apparaître
Une seconde à sa fenêtre
Et qui, preste, s'évanouit
Mais dont la svelte silhouette
Est si gracieuse et fluette
Qu'on en demeure épanoui
A la compagne de voyage
Dont les yeux, charmant paysage
Font paraître court le chemin
Qu'on est seul, peut-être, à comprendre
Et qu'on laisse pourtant descendre
Sans avoir effleuré sa main
A la fine et souple valseuse
Qui vous sembla triste et nerveuse
Par une nuit de carnaval
Qui voulut rester inconnue
Et qui n'est jamais revenue
Tournoyer dans un autre bal
A celles qui sont déjà prises
Et qui, vivant des heures grises
Près d'un être trop différent
Vous ont, inutile folie,
Laissé voir la mélancolie
D'un avenir désespérant
A ces timides amoureuses
Qui restèrent silencieuses
Et portent encor votre deuil
A celles qui s'en sont allées
Loin de vous, tristes esseulées
Victimes d'un stupide orgueil.
Chères images aperçues
Espérances d'un jour déçues
Vous serez dans l'oubli demain
Pour peu que le bonheur survienne
Il est rare qu'on se souvienne
Des épisodes du chemin
Mais si l'on a manqué sa vie
On songe avec un peu d'envie
A tous ces bonheurs entrevus
Aux baisers qu'on n'osa pas prendre
Aux coeurs qui doivent vous attendre
Aux yeux qu'on n'a jamais revus
Alors, aux soirs de lassitude
Tout en peuplant sa solitude
Des fantômes du souvenir
On pleure les lèvres absentes
De toutes ces belles passantes
Que l'on n'a pas su retenir
A toutes les femmes qu'on aime
Pendant quelques instants secrets
A celles qu'on connaît à peine
Qu'un destin différent entraîne
Et qu'on ne retrouve jamais
A celle qu'on voit apparaître
Une seconde à sa fenêtre
Et qui, preste, s'évanouit
Mais dont la svelte silhouette
Est si gracieuse et fluette
Qu'on en demeure épanoui
A la compagne de voyage
Dont les yeux, charmant paysage
Font paraître court le chemin
Qu'on est seul, peut-être, à comprendre
Et qu'on laisse pourtant descendre
Sans avoir effleuré sa main
A la fine et souple valseuse
Qui vous sembla triste et nerveuse
Par une nuit de carnaval
Qui voulut rester inconnue
Et qui n'est jamais revenue
Tournoyer dans un autre bal
A celles qui sont déjà prises
Et qui, vivant des heures grises
Près d'un être trop différent
Vous ont, inutile folie,
Laissé voir la mélancolie
D'un avenir désespérant
A ces timides amoureuses
Qui restèrent silencieuses
Et portent encor votre deuil
A celles qui s'en sont allées
Loin de vous, tristes esseulées
Victimes d'un stupide orgueil.
Chères images aperçues
Espérances d'un jour déçues
Vous serez dans l'oubli demain
Pour peu que le bonheur survienne
Il est rare qu'on se souvienne
Des épisodes du chemin
Mais si l'on a manqué sa vie
On songe avec un peu d'envie
A tous ces bonheurs entrevus
Aux baisers qu'on n'osa pas prendre
Aux coeurs qui doivent vous attendre
Aux yeux qu'on n'a jamais revus
Alors, aux soirs de lassitude
Tout en peuplant sa solitude
Des fantômes du souvenir
On pleure les lèvres absentes
De toutes ces belles passantes
Que l'on n'a pas su retenir

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Poésie
Poésie
LES ELEPHANTS 1855
Le sable rouge est comme une mer sans limite,
Et qui flambe, muette, affaissée en son lit.
Une ondulation immobile remplit
L' horizon aux vapeurs de cuivre où l' homme habite.
Nulle vie et nul bruit. Tous les lions repus
Dorment au fond de l' antre éloigné de cent lieues,
Et la girafe boit dans les fontaines bleues,
Là-bas, sous les dattiers des panthères connus.
Pas un oiseau ne passe en fouettant de son aile
L' air épais, où circule un immense soleil.
Parfois quelque boa, chauffé dans son sommeil,
Fait onduler son dos dont l' écaille étincelle.
Tel l' espace enflammé brûle sous les cieux clairs.
Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes,
Les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes,
Vont au pays natal à travers les déserts.
D' un point de l' horizon, comme des masses brunes,
Ils viennent, soulevant la poussière, et l' on voit,
Pour ne point dévier du chemin le plus droit,
Sous leur pied large et sûr crouler au loin les dunes.
Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps
Est gercé comme un tronc que le temps ronge et Mine;
Sa tête est comme un roc, et l' arc de son échine
Se voûte puissamment à ses moindres efforts.
Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche,
Il guide au but certain ses compagnons poudreux ;
Et, creusant par derrière un sillon sablonneux,
Les pèlerins massifs suivent leur patriarche.
L' oreille en éventail, la trompe entre les dents,
Ils cheminent, l' oeil clos. Leur ventre bat et fume,
Et leur sueur dans l' air embrasé monte en brume ;
Et bourdonnent autour mille insectes ardents.
Mais qu' importent la soif et la mouche vorace,
Et le soleil cuisant leur dos noir et plissé ?
Ils rêvent en marchant du pays délaissé,
Des forêts de figuiers où s' abrita leur race.
Ils reverront le fleuve échappé des grands monts,
Où nage en mugissant l' hippopotame énorme,
Où, blanchis par la lune et projetant leur forme,
Ils descendaient pour boire en écrasant les joncs.
Aussi, pleins de courage et de lenteur, ils Passent
Comme une ligne noire, au sable illimité ;
Et le désert reprend son immobilité
Quand les lourds voyageurs à l' horizon s' effacent.
Et qui flambe, muette, affaissée en son lit.
Une ondulation immobile remplit
L' horizon aux vapeurs de cuivre où l' homme habite.
Nulle vie et nul bruit. Tous les lions repus
Dorment au fond de l' antre éloigné de cent lieues,
Et la girafe boit dans les fontaines bleues,
Là-bas, sous les dattiers des panthères connus.
Pas un oiseau ne passe en fouettant de son aile
L' air épais, où circule un immense soleil.
Parfois quelque boa, chauffé dans son sommeil,
Fait onduler son dos dont l' écaille étincelle.
Tel l' espace enflammé brûle sous les cieux clairs.
Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes,
Les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes,
Vont au pays natal à travers les déserts.
D' un point de l' horizon, comme des masses brunes,
Ils viennent, soulevant la poussière, et l' on voit,
Pour ne point dévier du chemin le plus droit,
Sous leur pied large et sûr crouler au loin les dunes.
Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps
Est gercé comme un tronc que le temps ronge et Mine;
Sa tête est comme un roc, et l' arc de son échine
Se voûte puissamment à ses moindres efforts.
Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche,
Il guide au but certain ses compagnons poudreux ;
Et, creusant par derrière un sillon sablonneux,
Les pèlerins massifs suivent leur patriarche.
L' oreille en éventail, la trompe entre les dents,
Ils cheminent, l' oeil clos. Leur ventre bat et fume,
Et leur sueur dans l' air embrasé monte en brume ;
Et bourdonnent autour mille insectes ardents.
Mais qu' importent la soif et la mouche vorace,
Et le soleil cuisant leur dos noir et plissé ?
Ils rêvent en marchant du pays délaissé,
Des forêts de figuiers où s' abrita leur race.
Ils reverront le fleuve échappé des grands monts,
Où nage en mugissant l' hippopotame énorme,
Où, blanchis par la lune et projetant leur forme,
Ils descendaient pour boire en écrasant les joncs.
Aussi, pleins de courage et de lenteur, ils Passent
Comme une ligne noire, au sable illimité ;
Et le désert reprend son immobilité
Quand les lourds voyageurs à l' horizon s' effacent.

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Poésie
Poésie
L'azur
De l'éternel Azur la sereine ironie
Accable, belle indolemment comme les fleurs,
Le poëte impuissant qui maudit son génie
A travers un désert stérile de Douleurs.
Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde
Avec l'intensité d'un remords atterrant,
Mon âme vide. Où fuir ? Et quelle nuit hagarde
Jeter, lambeaux, jeter sur ce mépris navrant ?
Brouillards, montez ! versez vos cendres monotones
Avec de longs haillons de brume dans les cieux
Que noiera le marais livide des automnes,
Et bâtissez un grand plafond silencieux !
Et toi, sors des étangs léthéens et ramasse
En t'en venant la vase et les pâles roseaux,
Cher Ennui, pour boucher d'une main jamais lasse
Les grands trous bleus que font méchamment les oiseaux.
Encor ! que sans répit les tristes cheminées
Fument, et que de suie une errante prison
Eteigne dans l'horreur de ses noires traînées
Le soleil se mourant jaunâtre à l'horizon !
- Le Ciel est mort. - Vers toi, j'accours ! Donne, ô matière,
L'oubli de l'Idéal cruel et du Péché
A ce martyr qui vient partager la litière
Où le bétail heureux des hommes est couché,
Car j'y veux, puisque enfin ma cervelle, vidée
Comme le pot de fard gisant au pied d'un mur,
N'a plus l'art d'attifer la sanglotante idée,
Lugubrement bâiller vers un trépas obscur...
En vain ! l'Azur triomphe, et je l'entends qui chante
Dans les cloches. Mon âme, il se fait voix pour plus
Nous faire peur avec sa victoire méchante,
Et du métal vivant sort en bleus angelus !
Il roule par la brume, ancien et traverse
Ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr ;
Où fuir dans la révolte inutile et perverse ?
Je suis hanté. L'Azur ! l'Azur ! l'Azur ! l'Azur !
Accable, belle indolemment comme les fleurs,
Le poëte impuissant qui maudit son génie
A travers un désert stérile de Douleurs.
Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde
Avec l'intensité d'un remords atterrant,
Mon âme vide. Où fuir ? Et quelle nuit hagarde
Jeter, lambeaux, jeter sur ce mépris navrant ?
Brouillards, montez ! versez vos cendres monotones
Avec de longs haillons de brume dans les cieux
Que noiera le marais livide des automnes,
Et bâtissez un grand plafond silencieux !
Et toi, sors des étangs léthéens et ramasse
En t'en venant la vase et les pâles roseaux,
Cher Ennui, pour boucher d'une main jamais lasse
Les grands trous bleus que font méchamment les oiseaux.
Encor ! que sans répit les tristes cheminées
Fument, et que de suie une errante prison
Eteigne dans l'horreur de ses noires traînées
Le soleil se mourant jaunâtre à l'horizon !
- Le Ciel est mort. - Vers toi, j'accours ! Donne, ô matière,
L'oubli de l'Idéal cruel et du Péché
A ce martyr qui vient partager la litière
Où le bétail heureux des hommes est couché,
Car j'y veux, puisque enfin ma cervelle, vidée
Comme le pot de fard gisant au pied d'un mur,
N'a plus l'art d'attifer la sanglotante idée,
Lugubrement bâiller vers un trépas obscur...
En vain ! l'Azur triomphe, et je l'entends qui chante
Dans les cloches. Mon âme, il se fait voix pour plus
Nous faire peur avec sa victoire méchante,
Et du métal vivant sort en bleus angelus !
Il roule par la brume, ancien et traverse
Ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr ;
Où fuir dans la révolte inutile et perverse ?
Je suis hanté. L'Azur ! l'Azur ! l'Azur ! l'Azur !

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Poésie
Poésie
La Couronne Effeuillée
J' irai, j' irai porter ma couronne effeuillée
Au jardin de mon père où revit toute fleur ;
J' y répandrai longtemps mon âme agenouillée:
Non père a des secrets pour vaincre la douleur.
J' irai, j' irai lui dire, au moins avec mes larmes:
"Regardez, j' ai souffert... " il me regardera,
Et sous mes jours changés, sous mes pâleurs sans charmes,
Parce qu' il est mon père il me reconnaîtra.
Il dira : " c' est donc vous, chère âme désolée
La terre manque-t-elle à vos pas égarés ?
Chère âme, je suis Dieu : ne soyez plus troublée ;
Voici votre maison, voici mon coeur, entrez ! "
O clémence ! ô douceur ! ô saint refuge ! ô père !
Votre enfant qui pleurait vous l' avez entendu !
Je vous obtiens déjà puisque je vous espère
Et que vous possédez tout ce que j' ai perdu.
Vous ne rejetez pas la fleur qui n' est plus belle ;
Ce crime de la terre au ciel est pardonné.
Vous ne maudirez pas votre enfant infidèle,
Non d' avoir rien vendu, mais d' avoir tout donné
Au jardin de mon père où revit toute fleur ;
J' y répandrai longtemps mon âme agenouillée:
Non père a des secrets pour vaincre la douleur.
J' irai, j' irai lui dire, au moins avec mes larmes:
"Regardez, j' ai souffert... " il me regardera,
Et sous mes jours changés, sous mes pâleurs sans charmes,
Parce qu' il est mon père il me reconnaîtra.
Il dira : " c' est donc vous, chère âme désolée
La terre manque-t-elle à vos pas égarés ?
Chère âme, je suis Dieu : ne soyez plus troublée ;
Voici votre maison, voici mon coeur, entrez ! "
O clémence ! ô douceur ! ô saint refuge ! ô père !
Votre enfant qui pleurait vous l' avez entendu !
Je vous obtiens déjà puisque je vous espère
Et que vous possédez tout ce que j' ai perdu.
Vous ne rejetez pas la fleur qui n' est plus belle ;
Ce crime de la terre au ciel est pardonné.
Vous ne maudirez pas votre enfant infidèle,
Non d' avoir rien vendu, mais d' avoir tout donné

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Poésie
Poésie
LE REVE DU JAGUAR 1872
Sous les noirs acajous, les lianes en fleur,
Dans l' air lourd, immobile et saturé de mouches,
Pendent, et, s' enroulant en bas parmi les souches,
Bercent le perroquet splendide et querelleur,
L' araignée au dos jaune et les singes farouches.
C' est là que le tueur de boeufs et de chevaux,
Le long des vieux troncs morts à l' écorce moussue,
Sinistre et fatigué, revient à pas égaux.
Il va, frottant ses reins musculeux qu' il bossue ;
Et, du mufle béant par la soif alourdi,
Un souffle rauque et bref, d' une brusque secousse,
Trouble les grands lézards, chauds des feux de Midi,
Dont la fuite étincelle à travers l' herbe rousse.
En un creux du bois sombre interdit au soleil
Il s' affaisse, allongé sur quelque roche plate ;
D' un large coup de langue il se lustre la patte ;
Il cligne ses yeux d' or hébétés de sommeil ;
Et, dans l' illusion de ses forces inertes,
Faisant mouvoir sa queue et frissonner ses flancs,
Il rêve qu' au milieu des plantations vertes,
Il enfonce d' un bond ses ongles ruisselants
Dans la chair des taureaux effarés et beuglants
Dans l' air lourd, immobile et saturé de mouches,
Pendent, et, s' enroulant en bas parmi les souches,
Bercent le perroquet splendide et querelleur,
L' araignée au dos jaune et les singes farouches.
C' est là que le tueur de boeufs et de chevaux,
Le long des vieux troncs morts à l' écorce moussue,
Sinistre et fatigué, revient à pas égaux.
Il va, frottant ses reins musculeux qu' il bossue ;
Et, du mufle béant par la soif alourdi,
Un souffle rauque et bref, d' une brusque secousse,
Trouble les grands lézards, chauds des feux de Midi,
Dont la fuite étincelle à travers l' herbe rousse.
En un creux du bois sombre interdit au soleil
Il s' affaisse, allongé sur quelque roche plate ;
D' un large coup de langue il se lustre la patte ;
Il cligne ses yeux d' or hébétés de sommeil ;
Et, dans l' illusion de ses forces inertes,
Faisant mouvoir sa queue et frissonner ses flancs,
Il rêve qu' au milieu des plantations vertes,
Il enfonce d' un bond ses ongles ruisselants
Dans la chair des taureaux effarés et beuglants

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Re: Poésie
Re: Poésie
(Aux Victimes De l'ascention du Ballon Le Zenith)
I
Saturne, Jupiter, Vénus, n'ont plus de prêtres.
L'homme a donné les noms de tous ses anciens maîtres
A des astres qu'il pèse et qu'il a découverts,
Et des dieux le dernier dont le culte demeure,
A son tour menacé, tremble que tout à l'heure
Son nom ne serve plus qu'à nommer l'univers.
Les paradis s'en vont; dans l'immuable espace
Le vrai monde élargi les pousse ou les dépasse
Nous avons arraché sa barre à l'horizon,
Résolu d'un regard l'empyrée en poussières,
Et chassé le troupeau des idoles grossières
Sous le grand fouet d'éclairs que brandit la Raison.
Nous savons que le mur de la prison recule,
Que le pied peut franchir les colonnes d'Hercule,
Mais qu'en les franchissant il y revient bientôt;
Que la mer s'arrondit sous la course des voiles;
Qu'en trouant les enfers on revoit des étoiles;
Qu'en l'univers tout tombe, et qu'ainsi rien n'est haut.
Nous savons que la terre est sans piliers ni dôme,
Que l'infini l'égale au plus chétif atome;
Que l'espace est un vide ouvert de tous côtés,
Abîme où l'on surgit sans voir par où l'on entre,
Dont nous fuit la limite et dont nous suit le centre,
Habitacle de tout, sans laideurs ni beautés;
Que l'homme, fier néant, n'est qu'un des parasites
D'une sphère oubliée entre les plus petites,
Parasite à son tour des crins d'or du soleil;
Qu'à peine pesons-nous aux balances du gouffre,
Et que le plus haut cri de notre chair qui souffre
S'y perd comme un vain songe au fond d'un noir sommeil.
Eh bien ! quoique l'azur ait déçu nos sondages,
Nous lui rendons encore un vieux reste d'hommages;
Nous n'espérons jamais sans y lever les yeux.
D'où nous vient ce penchant à redresser la tête,
Ce geste, cher à l'homme, inutile à la bête,
Involontaire appel de la pensée aux cieux?
Est-ce de la foi morte un importun vestige?
Est-ce un pli séculaire et que rien ne corrige,
Par la race hérité des pâtres d'Orient
Est-ce un natif instinct propre à l'humain génie?
Ou n'est-ce qu'un hasard, la fortuite harmonie
D'un souriant désir et d'un bleu souriant?
Cet accord est profond, quelle qu'en soit la cause:
Dès que l'humanité fut au soleil éclose,
Elle a comme un calice ouvert au ciel son coeur;
Et, comme on voit planer un encens qui s'exhale,
Depuis lors, où bleuit la voûte colossale,
Plane son grand espoir, de sa raison vainqueur.
Et tant qu'on redira l'audace et l'infortune
Des premiers qu'a punis la divine rancune
Pour être allés ravir à ses sources le feu,
Les mortels frémiront d'épouvante et d'envie
A voir quelqu'un des leurs aventurer la vie
jusqu'aux bornes de l'air au pays de leur voeu;
Comme s'ils sentaient là leur chaine qui s'allège,
Et que ce fût encore un bonheur sacrilège;
Comme si Prométhée, après des milliers d'ans,
Pour nous encore aux dieux volant des étincelles,
Achevait aujourd'hui par l'osier des nacelles
L'attentat commencé par les rocs des Titans!
II
Élevez-vous, montez, sublimes Argonautes
Au-dessus de la neige, à des blancheurs plus hautes,
Aussi loin que se creuse à l'atmosphère un lieu !
Où monte le souci du front des astronomes,
Où monte le soupir du coeur des plus grands hommes,
Plus haut que nos saluts, plus loin que notre adieu !
Les câbles sont rompus : tout à coup seul et libre,
Le ballon qui poursuit son fuyant équilibre
S'engouffre, par l'espace aussitôt dévoré.
Dans un emportement qui ressemble à la joie,
Plus prompt que le faucon sur l'invisible proie,
Il s'élance, en glissant, vers son but ignoré.
Où vont ceux que ravit l'impétueuse allure
De cette étrange nef pendue à sa voilure,
Sans gouvernail ni proue, en une mer sans bord?
Au gré de tous les vents, traînés à la dérive,
Ne songent-ils qu'à tendre où nul vivant n'arrive,
Navigateurs lancés pour n'atteindre aucun port?
La foule ardente et fruste où survit Encelade
Dans leur ascension n'aime que l'escalade,
Les admire en tremblant et ne les comprend pas:
« S'ils ne sont point partis pour mordre à l'ambroisie,
Et voir en son entier la nature éclaircie,
Quel but, dit-elle, atteint ce formidable pas?
« S'ils ne sont point partis pour la cime des choses
Pour y voir frissonner la première des causes,
Et ce frisson courir au dernier des effets,
Pour aller jusqu'à Dieu lire dans ses yeux mêmes
Le mot de la justice et du bonheur suprêmes,
Quels profits leur courage étrange aura-t-il faits?»
Ils répondent : « La cause et la fin sont dans l'ombre;
Rien n'est sûr que le poids, la figure et le nombre,
Nous allons conquérir un chiffre seulement;
Ils sont loin les songeurs de Milet et d'Élée
Qui, pour vaincre en un jour tout l'inconnu d'emblée,
Tentaient sur l'univers un fol embrassement!
Nous ne nous flattons plus, comme ces vieux athlètes,
De forcer, sans flambeau, les ténèbres complètes,
Pour saisir à tâtons ce monstre corps à corps;
Il nous suffit, à nous, devant le sphinx énorme,
D'éclairer prudemment de point en point sa forme,
Et d'en lier les traits par de justes raccords.
Ils sont loin les rêveurs subtils d'Alexandrie,
Et ceux qui reniaient la terre pour patrie !
Nous ne nous flattons plus de la fuir, aujourd'hui:
A quelque évasion que l'air pur nous invite,
L'air même est notre geôle, avec nous il gravite,
II est terrestre encore, et tout l'azur c'est lui
Mais la terre suffit à soutenir la base
D'un triangle où l'algèbre a dépassé l'extase ;
L'astronomie atteint où ne ment plus l'azur
Sous des plafonds fuyants chasseresse d'étoiles
Elfe tisse, Arachné de l'infini, ses toiles,
Et suit de monde en monde un fil sublime et sûr.
Montés pour redescendre avec la même charge,
Nos corps lourds n'auront pu que faire un pas plus large,
Un orbe un peu plus haut sur le sol en rampant,
Mais nous aurons du moins goûté la certitude,
Ce qu'en vain demandaient les pères de l'étude
A leurs fronts isolés qu'ils s'en allaient frappant.
Et peut-être plus tard, si la pensée humaine
Touche au fond du mystère en tirant sur sa chaîne,
Le chiffre sans éclat qu'au ciel nous aurons lu,
Longtemps enseveli comme une valeur nulle,
Doit surgir glorieux dans l'unique formule
D'où le problème entier sortira résolu ! »
III
Ils montent! le ballon, qui pour nous diminue,
Fait pour eux s'effacer les contours de la nue,
S'abîmer la campagne, et l'horizon surgir
Grandissant comme on voit, sur une mer bien lisse,
Que du bout de son aile une mouette plisse,
Autour du point troublé les rides s'élargir.
Les plaines, les forets, les fleuves se déroulent,
Les monts humiliés en s'allongeant s'écroulent.
Le coeur semble se faire, à la merci des cieux,
Un berceau du péril dont pourtant il frissonne,
Et regarde sombrer tout ce qui l'emprisonne
Avec un abandon grave et délicieux...
Ils montent, épiant l'échelle où se mesure
L'audace du voyage au déclin du mercure,
Par la fuite du lest au ciel précipités;
Et cette cendre éparse, un moment radieuse,
Retourne se mêler à la poudre odieuse
De nos chemins étroits que leurs pieds ont quittés.
Depuis que la pensée, affranchissant la brute,
A découvert l'essor dans les lois de la chute,
Et su déraciner les pieds humains du sol,
L'homme a hanté des airs que nul oiseau n'explore.
Mais il n'avait jamais osé donner encore
Une aussi téméraire envergure à son vol !
Pourtant ils n'ont pas peur. La vérité suscite
Au plus timide front que son amour visite
Une sereine audace à l'épreuve de tout;
Immuable elle inspire à ses amants sa force,
Et, quand de ses beaux yeux on a suivi l'amorce,
Affamé de l'atteindre, on vit et meurt debout.
Ils goûtent du désert l'horreur libératrice.
Mais, si vite arrachée à sa ferme nourrice,
La chair tressaille en eux par un instinct d'enfant;
Serrant l'osier qui craque et n'osant lâcher prise,
Il semble qu'elle étreigne un lien qui se brise
Et pressente qu'en haut plus rien ne la défend.
Plus rien ne la défend, car elle n'est pas née
Pour une vagabonde et large destinée:
Il lui faut une assise, une borne, un chemin,
La tiédeur des vallons, et des toits l'ombre chère;
Ou la pensée aspire elle est une étrangère;
Il lui faut l'horizon tout proche de la main.
Surtout il lui faut l'air! L'air bientôt lui fait faute.
Alors s'élève entre elle et son invisible hôte,
Le génie aux destins de son argile uni,
L'éternelle dispute, agonie incessante
La chair, au sol vouée, implore la descente,
L'esprit ailé lui crie un sursum infini...
Maître, dit-elle, assez! mon angoisse m'accable...
-Plus haut ! lui répond-il. Et d'un long flot de sable
L'équipage allégé se rue au ciel profond.
-O maître, quel tourment ta volonté m'inflige!
Je succombe.-Plus haut! -Pitié! -Plus haut, te dis-je.
Et le sable épanché provoque un nouveau bond.
-Grâce, mon sang déborde et je n'ai plus d'haleine.
-Plus haut !- Arrêtons-nous ; maître, je vis à peine... -
Monte.- Oh! cruel, encor?-- Monte! esclave -Encore ? -Oui.
Mais épuisée enfin la chair plie et s'affaisse,
Et comme un feu sacré dont se meurt la prêtresse,
L'esprit abandonné s'abat évanoui.
IV
L'esquif, indifférent au fardeau qu'il balance,
Poursuit alors son vol dans un entier silence,
Désemparé du coeur et du génie humains,
Tandis qu'en bas s'agite une oublieuse foule,
Dont la moitié s'enivre, et l'autre moitié roule
Le rocher de Sisyphe où s'écorchent ses mains.
O fortune de l'homme! ou jouir sans noblesse,
Ou, noble, ne tenter qu'un essor qui le blesse!
Ou rire sans grandeur, ou grandir et pleurer!
S'il embrasse la terre, il abêtit sa joie,
S'il la chasse du pied, l'abîme l'y renvoie,
Il n'en peut pas sortir et n'y peut demeurer!
Car ni les fleurs d'un jour, ni les fruits qui se tachent,
Ni les amours qu'on pleure ou qu'on trahit n'attachent
Tous ceux que l'idéal caresse et mord au front;
Et s'ils veulent bondir au bleu qui les fascine,
Ils sont si rudement tirés, par la racine
Que beaucoup en sont morts, et combien en mourront!
Et c'est pourquoi ceux-là, ceux que l'infini hante,
Et qui sont bien vraiment, l'humanité souffrante
Si l'on souffre le plus par le plus grand désir,
Sentiront fuir toujours leur coeur et leur pensée
Avec cette nacelle éperdument lancée,
Et, devant sa détresse, un frisson les saisir.
V
Un seul s'est réveillé de ce funèbre somme,
Les deux autres... O vous, qu'un plus digne vous nomme,
Qu'un plus proche de vous dise qui vous étiez!
Moi, je salue en vous le genre humain qui monte,
Indomptable vaincu des cimes qu'il affronte,
Roi d'un astre, et pourtant jaloux des cieux entiers!
L'espérance a volé sur vos sublimes traces,
Enfants perdus, lancés en éclaireurs des races
Dans l'air supérieur, à nos songes trop cher,
Vous de qui la poitrine obstinément fidèle,
Défiant l'inconnu d'un immense coup d'aile,
Brava jusqu'à la mort l'irrespirable éther!
Mais quelle mort ! la chair, misérable martyre,
Retourne par son poids où la cendre l'attire,
Vos corps sont revenus demander des linceuls;
Vous les avez jetés, dernier lest, à la terre,
Et, laissant retomber le voile du mystère,
Vous avez achevé l'ascension tout seuls!
Pensée, amour, vouloir, tout ce qu'on nomme l'âme,
Toute la part de vous que l'infini réclame,
Plane encor, sans figure, anéanti? non pas!
Tel un vol de ramiers que son pays rappelle
Part, s'enfonce et s'efface en la plaine éternelle,
Mais n'y devient néant que pour les yeux d'en bas.
Mourir où les regards d'âge en âge s'élèvent,
Où tendent tous les fronts qui pensent et qui rêvent
Où se règlent les temps graver son souvenir!
Fonder au ciel sa gloire, et dans le grain qu'on sème
Sur terre propager le plus pur de soi-même,
C'est peut-être expirer, mais ce n'est pas finir :
Non! de sa vie à tous léguer l' oeuvre et l'exemple,
C'est la revivre en eux plus profonde et plus ample,
C'est durer dans l'espèce en tout temps, en tout lieu,
C'est finir d'exister dans l'air où l'heure sonne
Sous le fantôme étroit qui borne la personne,
Mais pour commencer d'être à la façon d'un dieu !
L'éternité du sage est dans les lois qu'il trouve;
Le délice éternel que le poète éprouve,
C'est un soir de durée au coeur des amoureux!
Car l'immortalité, l'âme de ceux qu'on aime,
C'est l'essence du bien, du beau, du vrai, Dieu même,
Et ceux-là seuls sont morts qui n'ont rien laissé d'eux.
O victimes, plus d'un peut-être vous jalouse,
Qui, de peur de languir et que l'oubli ne couse
Sur son oeuvre tardive un suaire étouffant,
Laisserait bien trancher sa destinée obscure
D'un pareil coup de faux, dont l'éclair transfigure
L'ombre d'un front sans gloire en nimbe triomphant!
Aux antiques rameaux, toujours verts, du Lycée,
Les générations, espoir de la pensée,
Rediront que pour elle on vous a vus périr:
Tous les coeurs de vingt ans, qui dédaignent la vie
Et dont la soif d'honneur n'est jamais assouvie,
Verront, en songe, au ciel votre tombeau fleurir.
Les antiques héros admireraient notre âge
Pour le nouvel emploi qu'on y fait du courage,
Et nous leur citerions le votre avec orgueil.
Mais l'orgueil consterné devant la mort s'efface,
Pardonnez au premier que votre belle audace
Et l'amour de l'azur arrachèrent au deuil.
Saturne, Jupiter, Vénus, n'ont plus de prêtres.
L'homme a donné les noms de tous ses anciens maîtres
A des astres qu'il pèse et qu'il a découverts,
Et des dieux le dernier dont le culte demeure,
A son tour menacé, tremble que tout à l'heure
Son nom ne serve plus qu'à nommer l'univers.
Les paradis s'en vont; dans l'immuable espace
Le vrai monde élargi les pousse ou les dépasse
Nous avons arraché sa barre à l'horizon,
Résolu d'un regard l'empyrée en poussières,
Et chassé le troupeau des idoles grossières
Sous le grand fouet d'éclairs que brandit la Raison.
Nous savons que le mur de la prison recule,
Que le pied peut franchir les colonnes d'Hercule,
Mais qu'en les franchissant il y revient bientôt;
Que la mer s'arrondit sous la course des voiles;
Qu'en trouant les enfers on revoit des étoiles;
Qu'en l'univers tout tombe, et qu'ainsi rien n'est haut.
Nous savons que la terre est sans piliers ni dôme,
Que l'infini l'égale au plus chétif atome;
Que l'espace est un vide ouvert de tous côtés,
Abîme où l'on surgit sans voir par où l'on entre,
Dont nous fuit la limite et dont nous suit le centre,
Habitacle de tout, sans laideurs ni beautés;
Que l'homme, fier néant, n'est qu'un des parasites
D'une sphère oubliée entre les plus petites,
Parasite à son tour des crins d'or du soleil;
Qu'à peine pesons-nous aux balances du gouffre,
Et que le plus haut cri de notre chair qui souffre
S'y perd comme un vain songe au fond d'un noir sommeil.
Eh bien ! quoique l'azur ait déçu nos sondages,
Nous lui rendons encore un vieux reste d'hommages;
Nous n'espérons jamais sans y lever les yeux.
D'où nous vient ce penchant à redresser la tête,
Ce geste, cher à l'homme, inutile à la bête,
Involontaire appel de la pensée aux cieux?
Est-ce de la foi morte un importun vestige?
Est-ce un pli séculaire et que rien ne corrige,
Par la race hérité des pâtres d'Orient
Est-ce un natif instinct propre à l'humain génie?
Ou n'est-ce qu'un hasard, la fortuite harmonie
D'un souriant désir et d'un bleu souriant?
Cet accord est profond, quelle qu'en soit la cause:
Dès que l'humanité fut au soleil éclose,
Elle a comme un calice ouvert au ciel son coeur;
Et, comme on voit planer un encens qui s'exhale,
Depuis lors, où bleuit la voûte colossale,
Plane son grand espoir, de sa raison vainqueur.
Et tant qu'on redira l'audace et l'infortune
Des premiers qu'a punis la divine rancune
Pour être allés ravir à ses sources le feu,
Les mortels frémiront d'épouvante et d'envie
A voir quelqu'un des leurs aventurer la vie
jusqu'aux bornes de l'air au pays de leur voeu;
Comme s'ils sentaient là leur chaine qui s'allège,
Et que ce fût encore un bonheur sacrilège;
Comme si Prométhée, après des milliers d'ans,
Pour nous encore aux dieux volant des étincelles,
Achevait aujourd'hui par l'osier des nacelles
L'attentat commencé par les rocs des Titans!
II
Élevez-vous, montez, sublimes Argonautes
Au-dessus de la neige, à des blancheurs plus hautes,
Aussi loin que se creuse à l'atmosphère un lieu !
Où monte le souci du front des astronomes,
Où monte le soupir du coeur des plus grands hommes,
Plus haut que nos saluts, plus loin que notre adieu !
Les câbles sont rompus : tout à coup seul et libre,
Le ballon qui poursuit son fuyant équilibre
S'engouffre, par l'espace aussitôt dévoré.
Dans un emportement qui ressemble à la joie,
Plus prompt que le faucon sur l'invisible proie,
Il s'élance, en glissant, vers son but ignoré.
Où vont ceux que ravit l'impétueuse allure
De cette étrange nef pendue à sa voilure,
Sans gouvernail ni proue, en une mer sans bord?
Au gré de tous les vents, traînés à la dérive,
Ne songent-ils qu'à tendre où nul vivant n'arrive,
Navigateurs lancés pour n'atteindre aucun port?
La foule ardente et fruste où survit Encelade
Dans leur ascension n'aime que l'escalade,
Les admire en tremblant et ne les comprend pas:
« S'ils ne sont point partis pour mordre à l'ambroisie,
Et voir en son entier la nature éclaircie,
Quel but, dit-elle, atteint ce formidable pas?
« S'ils ne sont point partis pour la cime des choses
Pour y voir frissonner la première des causes,
Et ce frisson courir au dernier des effets,
Pour aller jusqu'à Dieu lire dans ses yeux mêmes
Le mot de la justice et du bonheur suprêmes,
Quels profits leur courage étrange aura-t-il faits?»
Ils répondent : « La cause et la fin sont dans l'ombre;
Rien n'est sûr que le poids, la figure et le nombre,
Nous allons conquérir un chiffre seulement;
Ils sont loin les songeurs de Milet et d'Élée
Qui, pour vaincre en un jour tout l'inconnu d'emblée,
Tentaient sur l'univers un fol embrassement!
Nous ne nous flattons plus, comme ces vieux athlètes,
De forcer, sans flambeau, les ténèbres complètes,
Pour saisir à tâtons ce monstre corps à corps;
Il nous suffit, à nous, devant le sphinx énorme,
D'éclairer prudemment de point en point sa forme,
Et d'en lier les traits par de justes raccords.
Ils sont loin les rêveurs subtils d'Alexandrie,
Et ceux qui reniaient la terre pour patrie !
Nous ne nous flattons plus de la fuir, aujourd'hui:
A quelque évasion que l'air pur nous invite,
L'air même est notre geôle, avec nous il gravite,
II est terrestre encore, et tout l'azur c'est lui
Mais la terre suffit à soutenir la base
D'un triangle où l'algèbre a dépassé l'extase ;
L'astronomie atteint où ne ment plus l'azur
Sous des plafonds fuyants chasseresse d'étoiles
Elfe tisse, Arachné de l'infini, ses toiles,
Et suit de monde en monde un fil sublime et sûr.
Montés pour redescendre avec la même charge,
Nos corps lourds n'auront pu que faire un pas plus large,
Un orbe un peu plus haut sur le sol en rampant,
Mais nous aurons du moins goûté la certitude,
Ce qu'en vain demandaient les pères de l'étude
A leurs fronts isolés qu'ils s'en allaient frappant.
Et peut-être plus tard, si la pensée humaine
Touche au fond du mystère en tirant sur sa chaîne,
Le chiffre sans éclat qu'au ciel nous aurons lu,
Longtemps enseveli comme une valeur nulle,
Doit surgir glorieux dans l'unique formule
D'où le problème entier sortira résolu ! »
III
Ils montent! le ballon, qui pour nous diminue,
Fait pour eux s'effacer les contours de la nue,
S'abîmer la campagne, et l'horizon surgir
Grandissant comme on voit, sur une mer bien lisse,
Que du bout de son aile une mouette plisse,
Autour du point troublé les rides s'élargir.
Les plaines, les forets, les fleuves se déroulent,
Les monts humiliés en s'allongeant s'écroulent.
Le coeur semble se faire, à la merci des cieux,
Un berceau du péril dont pourtant il frissonne,
Et regarde sombrer tout ce qui l'emprisonne
Avec un abandon grave et délicieux...
Ils montent, épiant l'échelle où se mesure
L'audace du voyage au déclin du mercure,
Par la fuite du lest au ciel précipités;
Et cette cendre éparse, un moment radieuse,
Retourne se mêler à la poudre odieuse
De nos chemins étroits que leurs pieds ont quittés.
Depuis que la pensée, affranchissant la brute,
A découvert l'essor dans les lois de la chute,
Et su déraciner les pieds humains du sol,
L'homme a hanté des airs que nul oiseau n'explore.
Mais il n'avait jamais osé donner encore
Une aussi téméraire envergure à son vol !
Pourtant ils n'ont pas peur. La vérité suscite
Au plus timide front que son amour visite
Une sereine audace à l'épreuve de tout;
Immuable elle inspire à ses amants sa force,
Et, quand de ses beaux yeux on a suivi l'amorce,
Affamé de l'atteindre, on vit et meurt debout.
Ils goûtent du désert l'horreur libératrice.
Mais, si vite arrachée à sa ferme nourrice,
La chair tressaille en eux par un instinct d'enfant;
Serrant l'osier qui craque et n'osant lâcher prise,
Il semble qu'elle étreigne un lien qui se brise
Et pressente qu'en haut plus rien ne la défend.
Plus rien ne la défend, car elle n'est pas née
Pour une vagabonde et large destinée:
Il lui faut une assise, une borne, un chemin,
La tiédeur des vallons, et des toits l'ombre chère;
Ou la pensée aspire elle est une étrangère;
Il lui faut l'horizon tout proche de la main.
Surtout il lui faut l'air! L'air bientôt lui fait faute.
Alors s'élève entre elle et son invisible hôte,
Le génie aux destins de son argile uni,
L'éternelle dispute, agonie incessante
La chair, au sol vouée, implore la descente,
L'esprit ailé lui crie un sursum infini...
Maître, dit-elle, assez! mon angoisse m'accable...
-Plus haut ! lui répond-il. Et d'un long flot de sable
L'équipage allégé se rue au ciel profond.
-O maître, quel tourment ta volonté m'inflige!
Je succombe.-Plus haut! -Pitié! -Plus haut, te dis-je.
Et le sable épanché provoque un nouveau bond.
-Grâce, mon sang déborde et je n'ai plus d'haleine.
-Plus haut !- Arrêtons-nous ; maître, je vis à peine... -
Monte.- Oh! cruel, encor?-- Monte! esclave -Encore ? -Oui.
Mais épuisée enfin la chair plie et s'affaisse,
Et comme un feu sacré dont se meurt la prêtresse,
L'esprit abandonné s'abat évanoui.
IV
L'esquif, indifférent au fardeau qu'il balance,
Poursuit alors son vol dans un entier silence,
Désemparé du coeur et du génie humains,
Tandis qu'en bas s'agite une oublieuse foule,
Dont la moitié s'enivre, et l'autre moitié roule
Le rocher de Sisyphe où s'écorchent ses mains.
O fortune de l'homme! ou jouir sans noblesse,
Ou, noble, ne tenter qu'un essor qui le blesse!
Ou rire sans grandeur, ou grandir et pleurer!
S'il embrasse la terre, il abêtit sa joie,
S'il la chasse du pied, l'abîme l'y renvoie,
Il n'en peut pas sortir et n'y peut demeurer!
Car ni les fleurs d'un jour, ni les fruits qui se tachent,
Ni les amours qu'on pleure ou qu'on trahit n'attachent
Tous ceux que l'idéal caresse et mord au front;
Et s'ils veulent bondir au bleu qui les fascine,
Ils sont si rudement tirés, par la racine
Que beaucoup en sont morts, et combien en mourront!
Et c'est pourquoi ceux-là, ceux que l'infini hante,
Et qui sont bien vraiment, l'humanité souffrante
Si l'on souffre le plus par le plus grand désir,
Sentiront fuir toujours leur coeur et leur pensée
Avec cette nacelle éperdument lancée,
Et, devant sa détresse, un frisson les saisir.
V
Un seul s'est réveillé de ce funèbre somme,
Les deux autres... O vous, qu'un plus digne vous nomme,
Qu'un plus proche de vous dise qui vous étiez!
Moi, je salue en vous le genre humain qui monte,
Indomptable vaincu des cimes qu'il affronte,
Roi d'un astre, et pourtant jaloux des cieux entiers!
L'espérance a volé sur vos sublimes traces,
Enfants perdus, lancés en éclaireurs des races
Dans l'air supérieur, à nos songes trop cher,
Vous de qui la poitrine obstinément fidèle,
Défiant l'inconnu d'un immense coup d'aile,
Brava jusqu'à la mort l'irrespirable éther!
Mais quelle mort ! la chair, misérable martyre,
Retourne par son poids où la cendre l'attire,
Vos corps sont revenus demander des linceuls;
Vous les avez jetés, dernier lest, à la terre,
Et, laissant retomber le voile du mystère,
Vous avez achevé l'ascension tout seuls!
Pensée, amour, vouloir, tout ce qu'on nomme l'âme,
Toute la part de vous que l'infini réclame,
Plane encor, sans figure, anéanti? non pas!
Tel un vol de ramiers que son pays rappelle
Part, s'enfonce et s'efface en la plaine éternelle,
Mais n'y devient néant que pour les yeux d'en bas.
Mourir où les regards d'âge en âge s'élèvent,
Où tendent tous les fronts qui pensent et qui rêvent
Où se règlent les temps graver son souvenir!
Fonder au ciel sa gloire, et dans le grain qu'on sème
Sur terre propager le plus pur de soi-même,
C'est peut-être expirer, mais ce n'est pas finir :
Non! de sa vie à tous léguer l' oeuvre et l'exemple,
C'est la revivre en eux plus profonde et plus ample,
C'est durer dans l'espèce en tout temps, en tout lieu,
C'est finir d'exister dans l'air où l'heure sonne
Sous le fantôme étroit qui borne la personne,
Mais pour commencer d'être à la façon d'un dieu !
L'éternité du sage est dans les lois qu'il trouve;
Le délice éternel que le poète éprouve,
C'est un soir de durée au coeur des amoureux!
Car l'immortalité, l'âme de ceux qu'on aime,
C'est l'essence du bien, du beau, du vrai, Dieu même,
Et ceux-là seuls sont morts qui n'ont rien laissé d'eux.
O victimes, plus d'un peut-être vous jalouse,
Qui, de peur de languir et que l'oubli ne couse
Sur son oeuvre tardive un suaire étouffant,
Laisserait bien trancher sa destinée obscure
D'un pareil coup de faux, dont l'éclair transfigure
L'ombre d'un front sans gloire en nimbe triomphant!
Aux antiques rameaux, toujours verts, du Lycée,
Les générations, espoir de la pensée,
Rediront que pour elle on vous a vus périr:
Tous les coeurs de vingt ans, qui dédaignent la vie
Et dont la soif d'honneur n'est jamais assouvie,
Verront, en songe, au ciel votre tombeau fleurir.
Les antiques héros admireraient notre âge
Pour le nouvel emploi qu'on y fait du courage,
Et nous leur citerions le votre avec orgueil.
Mais l'orgueil consterné devant la mort s'efface,
Pardonnez au premier que votre belle audace
Et l'amour de l'azur arrachèrent au deuil.

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Poésie
Poésie
La Mort Du Loup
Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon.
Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. -Ni le bois ni la plaine
Ne poussaient un soupir dans les airs; seulement
La girouette en deuil criait au firmament;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres,
N'effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête
A regardé le sable en s'y couchant; bientôt,
Lui que jamais ici l'on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions, pas à pas, en écartant les branches.
Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient,
J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse,
Mais les enfants du Loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi,
Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa Louve reposait comme celle de marbre
Qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées,
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante,
Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair,
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang;
Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.
II
J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre
A poursuivre sa Louve et ses fils, qui, tous trois,
Avaient voulu l'attendre; et, comme je le crois,
Sans ses deux Louveteaux, la belle et sombre veuve
Ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
A ne jamais entrer dans le pacte des villes
Que l'homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.
III
Hélas! ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Hommes,
Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes!
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C'est vous qui le savez, sublimes animaux!
A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse,
Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse.
-Ah! je t'ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur!
Il disait : " Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A force de rester studieuse et pensive,
Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté.
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler. "
Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon.
Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. -Ni le bois ni la plaine
Ne poussaient un soupir dans les airs; seulement
La girouette en deuil criait au firmament;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres,
N'effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête
A regardé le sable en s'y couchant; bientôt,
Lui que jamais ici l'on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions, pas à pas, en écartant les branches.
Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient,
J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse,
Mais les enfants du Loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi,
Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa Louve reposait comme celle de marbre
Qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées,
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante,
Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair,
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang;
Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.
II
J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre
A poursuivre sa Louve et ses fils, qui, tous trois,
Avaient voulu l'attendre; et, comme je le crois,
Sans ses deux Louveteaux, la belle et sombre veuve
Ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
A ne jamais entrer dans le pacte des villes
Que l'homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.
III
Hélas! ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Hommes,
Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes!
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C'est vous qui le savez, sublimes animaux!
A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse,
Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse.
-Ah! je t'ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur!
Il disait : " Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A force de rester studieuse et pensive,
Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté.
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler. "

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 citations
citations
Allais, Alphonse (1855-1905), écrivain français célèbre pour ses historiettes loufoques. D'abord photographe, puis journaliste, il publia ses premiers textes, simples calembredaines ou petits récits, dans la presse, avant de les réunir en volumes: À se tordre (1891), Vive la vie (1892) et Amours, délices et orgues (1898). On lui doit aussi quelques comédies savoureuses, écrites seul ou en collaboration. La fantaisie légendaire de l'écrivain et la cocasserie de sa plume font de lui le parfait représentant de l'anarchie légère de la Belle Époque. On a pu rapprocher son personnage le plus connu, Captain Cap (Captain Cap, 1902), de celui d'Ubu, d'Alfred Jarry, comme lui joyeusement irrespectueux de l'ordre établi. L'absurdité fréquente des situations correspond à une critique de la bêtise petite-bourgeoise où pointe parfois un pessimisme grave.
Avant de prendre congé de ses hôtes, Dieu convint, de la meilleure grâce du monde, qu'il n'existait pas
C'est le fond qui manque le moins, mais ce sont les fonds qui manquent le plus.
C'est parce que la fortune vient en dormant que celle-ci arrive si lentement.
C’est quand on serre une femme de trop près qu’elle trouve qu’on va trop loin.
Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même, et encore, pas beaucoup.
Dans sa volonté de supprimer les intermédiaires, il cherchait le moyen de passer directement du foin au lait sans passer par la vache.
Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la mort; sans cela, que saurait-on de la vie?
Et Jean tua Madeleine. Ce fut à peu près vers cette époque que Madeleine perdit l'habitude de tromper Jean.
Il ne faut jamais faire de projets, surtout en ce qui concerne l'avenir.
Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut encore savoir s'en servir.
Il vaut mieux passer à La Poste hériter qu'à la postérité!
Il y a des femmes qui sont comme le bâton enduit de confiture de roses dont parle le poète persan: on ne sait par quel bout les prendre.
Il était normand par sa mère et breton par un ami de son père.
J'ai connu bien des filles de joie qui avaient pour père un homme de peine.
je bois pour oublier que je suis un ivrogne.
Je ne prendrai pas de calendrier cette année, car j'ai été très mécontent de celui de l'année dernière!
L'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite...
L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si l'on songe à l'époque où il fut créé.
L'homme propose (la femme accepte souvent) et Dieu dispose.
La femme est le chef-d'oeuvre de Dieu surtout quand elle a le diable au corps.
La grande trouvaille de l'armée, c'est qu'elle est la seule à avoir compris que la compétence ne se lit pas sur le visage. Elle a donc inventé les grades.
La lune est pleine et on ne sait pas qui l'a mise dans cet état.
La misère a cela de bon, qu'elle supprime la crainte des voleurs.
Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression.
Les champignons poussent dans les endroits humides. C'est pourquoi ils ont la forme d'un parapluie.
Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables.
Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux.
Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de faire leur chemin.
Les plus belles stratégies s’écrivent au passé.
Les tarifs de chemins de fer sont aménagés d’une manière imbécile. On devrait faire payer des suppléments pour les retours... puisque les gens sont forcés de revenir.
L’autobus est un véhicule dans lequel il y a toujours de la place quand il va dans la direction opposée.
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.
On a dit que le génie était une longue patience. Et le mariage donc?
Quand il suffit d'un rien, on n'a pas besoin de grand-chose.
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue.
Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui se désespère avec la réalité.
Un paresseux est un homme qui ne fait pas semblant de travailler.
--------------------------------------------------------------------------------
Avant de prendre congé de ses hôtes, Dieu convint, de la meilleure grâce du monde, qu'il n'existait pas
C'est le fond qui manque le moins, mais ce sont les fonds qui manquent le plus.
C'est parce que la fortune vient en dormant que celle-ci arrive si lentement.
C’est quand on serre une femme de trop près qu’elle trouve qu’on va trop loin.
Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même, et encore, pas beaucoup.
Dans sa volonté de supprimer les intermédiaires, il cherchait le moyen de passer directement du foin au lait sans passer par la vache.
Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la mort; sans cela, que saurait-on de la vie?
Et Jean tua Madeleine. Ce fut à peu près vers cette époque que Madeleine perdit l'habitude de tromper Jean.
Il ne faut jamais faire de projets, surtout en ce qui concerne l'avenir.
Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut encore savoir s'en servir.
Il vaut mieux passer à La Poste hériter qu'à la postérité!
Il y a des femmes qui sont comme le bâton enduit de confiture de roses dont parle le poète persan: on ne sait par quel bout les prendre.
Il était normand par sa mère et breton par un ami de son père.
J'ai connu bien des filles de joie qui avaient pour père un homme de peine.
je bois pour oublier que je suis un ivrogne.
Je ne prendrai pas de calendrier cette année, car j'ai été très mécontent de celui de l'année dernière!
L'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite...
L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si l'on songe à l'époque où il fut créé.
L'homme propose (la femme accepte souvent) et Dieu dispose.
La femme est le chef-d'oeuvre de Dieu surtout quand elle a le diable au corps.
La grande trouvaille de l'armée, c'est qu'elle est la seule à avoir compris que la compétence ne se lit pas sur le visage. Elle a donc inventé les grades.
La lune est pleine et on ne sait pas qui l'a mise dans cet état.
La misère a cela de bon, qu'elle supprime la crainte des voleurs.
Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression.
Les champignons poussent dans les endroits humides. C'est pourquoi ils ont la forme d'un parapluie.
Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables.
Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux.
Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux femmes de faire leur chemin.
Les plus belles stratégies s’écrivent au passé.
Les tarifs de chemins de fer sont aménagés d’une manière imbécile. On devrait faire payer des suppléments pour les retours... puisque les gens sont forcés de revenir.
L’autobus est un véhicule dans lequel il y a toujours de la place quand il va dans la direction opposée.
Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain.
On a dit que le génie était une longue patience. Et le mariage donc?
Quand il suffit d'un rien, on n'a pas besoin de grand-chose.
Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue.
Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est infiniment plus malin que celui qui se désespère avec la réalité.
Un paresseux est un homme qui ne fait pas semblant de travailler.

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 La Nuit Transfigurée
La Nuit Transfigurée
La Nuit Transfigurée
I
Ce flot de vent d'ombre et d'étoile
Au ciel immense qui se voile
Te fait trahir,
D'une lumière qui lointaine
Baigne tes songes de sirène
Et d'avenir,
II
Lueur de feu qui grève d'ombre
Tes yeux immenses qui font sombre
Dans les soleils,
D'une fontaine de silence
Qu'un froid stellaire étreint d'absence
Tes yeux vermeils.
III
Et la pâleur d'eau où se mire
Un soir étrange qui transpire
D' abolitions,
Jusqu' à penser à la paresse
Que dans un rêve de tristesse
Nous nous faisons,
IV
Songe de nuit et d'amertume
Quand nous de nos ailes sans plume,
A parcourir
Ce feu d'étoile qui chancelle,
Nous cherchons la flamme nouvelle
Jusqu' à mourir. . .
V
Ce vent de feu qui monte vite
Et cette lèvre qui m'invite
A t'embrasser,
Dans un voyage dont j'avais
Prévu les chemins que tu sais
Ensorceler,
VI
Ce soir étrange de sommeil
Qui nous conduit dans le soleil
D'ombre étoilée,
Nous ferons somme de langueur
Dans une vague de rumeur,
Transfigurée
Ce flot de vent d'ombre et d'étoile
Au ciel immense qui se voile
Te fait trahir,
D'une lumière qui lointaine
Baigne tes songes de sirène
Et d'avenir,
II
Lueur de feu qui grève d'ombre
Tes yeux immenses qui font sombre
Dans les soleils,
D'une fontaine de silence
Qu'un froid stellaire étreint d'absence
Tes yeux vermeils.
III
Et la pâleur d'eau où se mire
Un soir étrange qui transpire
D' abolitions,
Jusqu' à penser à la paresse
Que dans un rêve de tristesse
Nous nous faisons,
IV
Songe de nuit et d'amertume
Quand nous de nos ailes sans plume,
A parcourir
Ce feu d'étoile qui chancelle,
Nous cherchons la flamme nouvelle
Jusqu' à mourir. . .
V
Ce vent de feu qui monte vite
Et cette lèvre qui m'invite
A t'embrasser,
Dans un voyage dont j'avais
Prévu les chemins que tu sais
Ensorceler,
VI
Ce soir étrange de sommeil
Qui nous conduit dans le soleil
D'ombre étoilée,
Nous ferons somme de langueur
Dans une vague de rumeur,
Transfigurée

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

 Citations
Citations
Aragon, Louis (1897-1982), écrivain et poète français. Fils illégitime d'un haut fonctionnaire de la IIIème république, élevé dans une bourgeoisie déclassée, bachelier en 1915, il entreprit des études de médecine durant lequelle il fit la connaissance d'André Breton. Mobilisé en 1917, il retrouva son ami après la guerre et participa, avec lui et Philippe Soupault, à la création de la revue Littérature (1919). Il publia un premier recueil de poèmes (Feu de joie), puis, après avoir pris part à quelques manifestations de Dada, s'engagea dans des recherches littéraires qui aboutîrent au surréalisme, rédigeant successivement un texte ironique (Anicet ou le panorama, 1921), un pastiche du roman didactique de Fénelon (les Aventures de Télémaque, 1922), et un recueil de nouvelles (le Libertinage, 1924). L'année même où paraissait le premier Manifeste de Breton, Aragon exposa sa propre conception du surréalisme dans un texte théorique (Une vague de rêve, 1924), prônant le "merveilleux quotidien", issu de la rencontre de l'imaginaire avec le réel, et se révélant spécialement attentif au problème de la description littéraire (le Paysan de Paris, 1926). En 1927, Aragon adhéra au Parti communiste, et rompu avec le surréalisme en 1932. La rencontre du poète avec Elsa Triolet, en 1928, fut déterminante ; d'origine russe, elle l'amena à se placer au service de la révolution et contribua à l'éloigner de Breton. Sa production des années trente se compose essentiellement des romans appartenant au cycle intitulé Le Monde réel (les Cloches de Bâle, 1933 ; les Beaux Quartiers, 1936 ; les Voyageurs de l'impériale, 1942), dans lequel l'auteur se livre à une évocation sans complaisance de la France bourgeoise du début du siècle, s'inspirant des thèses du réalisme socialiste. Mobilisé en 1939, Aragon rejoignit le Parti communiste, devenu clandestin en 1941, et organisa un réseau de résistance en zone sud. Il revint alors à la création littéraire, et fit paraître sous le manteau des poèmes où se conjuguent, par l'assimilation de la France à la femme aimée, patriotisme et élans amoureux (le Crève-Cœur, 1941 ; les Yeux d'Elsa, 1942 ; Brocéliande, 1942 ; le Musée Grévin, 1943 ; la Diane française, 1945). À la Libération, il publia son roman le plus célèbre, Aurélien (1945), le quatrième volume de la fresque du Monde réel, qui est sans doute une des œuvres majeures du XXème siècle. Ce récit d'amour s'ouvre, de manière très significative, par une phrase où domine la mise à distance ("La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide"), qui préfigure l'impression de scepticisme et d'indifférence qui se dégage de l'ensemble du livre, véritable reflet de l'agitation et de l'instabilité de la société de l'après-guerre. Quant au dernier roman du cycle du Monde réel (les Communistes, 1949), il apparaît comme l'œuvre la plus militante d'Aragon. Entré aux Lettres françaises en 1949, il prit la direction de la revue en 1953 (et conservera son poste de directeur jusqu'en 1972). L'année suivante, il fut nommé membre du Comité central du Parti communiste, mais les excès du stalinisme le déterminèrent à se consacrer désormais presque exclusivement à son œuvre. Alors que le Roman inachevé (1956) est un recueil de poèmes d'inspiration autobiographique où se lit un retour à certains traits de la poétique surréaliste, Fou d'Elsa (1963) et Il ne m'est Paris que d'Elsa (1964) s'inscrivent dans la continuité du thème de la célébration de la femme, inauguré dans les poèmes engagés de la Résistance. La Semaine sainte (1958), roman historique, renouvelle l'inspiration d'Aragon ; son œuvre se nourrit désormais d'une interrogation sur la création artistique et sur la conscience (la Mise à mort, 1965 ; Blanche ou l'Oubli, 1967 et Théâtre/Roman, 1974). Le Mentir-vrai, titre d'un recueil de nouvelles publiées en 1980, est caractéristique des contradictions que la critique ne manqua pas de relever à propos de la vie et de l'œuvre d'Aragon. Correspondant à la fois à un désir de communication sincère et à un goût prononcé pour le masque et les énigmes, la diversité de sa création témoigne de la passion d'Aragon pour l'exploration de l'inconnu, qui le ramena, finalement, à assimiler l'écriture à une quête de soi.
A toute erreur des sens correspondent d'étranges fleurs de raison.
De la femme vient la lumière.
En France tout finit par des fleurs de rhétorique.
Il est permis de rêver. Il est recommandé de rêver. Sur les livres et les souvenirs. Sur l'Histoire et sur la vie.
Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre. Mon amour...
Il est temps d'instaurer la religion de l'amour.
Il n'y a pas de poésie, si lointaine qu'on la prétende des circonstances, qui ne tienne des circonstances sa force, sa naissance et son prolongement.
'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir.
Jamais peut-être faire chanter les choses n'a été plus urgente et noble mission à l'homme.
Je n'ai jamais rien demandé à ce que je lis que le vertige.
Je ne serai pour personne une excuse, pour personne un exemple.
Jusqu'ici, les romanciers se sont contentés de parodier le monde. Il s'agit maintenant de l'inventer.
L'avenir c'est ce qui dépasse la main tendue.
L'enfer existe. Il est la part du plus grand nombre.
La parole n'a pas été donnée à l'homme: il l'a prise.
La poésie, notre poésie se lit comme le journal. Le journal du monde qui va venir.
La vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui, pour effacer ses traces.
Le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d'années plus tard.
Un beau soir l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse.

--------------------------------------------------------------------------------
A toute erreur des sens correspondent d'étranges fleurs de raison.
De la femme vient la lumière.
En France tout finit par des fleurs de rhétorique.
Il est permis de rêver. Il est recommandé de rêver. Sur les livres et les souvenirs. Sur l'Histoire et sur la vie.
Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre. Mon amour...
Il est temps d'instaurer la religion de l'amour.
Il n'y a pas de poésie, si lointaine qu'on la prétende des circonstances, qui ne tienne des circonstances sa force, sa naissance et son prolongement.
'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir.
Jamais peut-être faire chanter les choses n'a été plus urgente et noble mission à l'homme.
Je n'ai jamais rien demandé à ce que je lis que le vertige.
Je ne serai pour personne une excuse, pour personne un exemple.
Jusqu'ici, les romanciers se sont contentés de parodier le monde. Il s'agit maintenant de l'inventer.
L'avenir c'est ce qui dépasse la main tendue.
L'enfer existe. Il est la part du plus grand nombre.
La parole n'a pas été donnée à l'homme: il l'a prise.
La poésie, notre poésie se lit comme le journal. Le journal du monde qui va venir.
La vie est un voyageur qui laisse traîner son manteau derrière lui, pour effacer ses traces.
Le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d'années plus tard.
Un beau soir l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse.

crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -


crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des: -

Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum



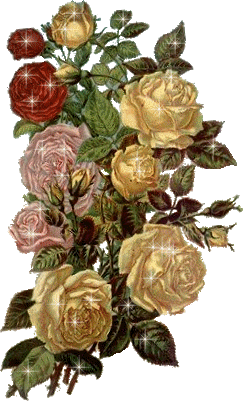










» Image du jour (mdrrrrrrrrrrr)
» Carnet du jour
» Cartes météo
» Horoscope
» Paris-Nice
» Résultats
» pommes au carambar
» Tournoi des 6 nations
» Ailerons de poulet au curry
» Amandines au chocolat
» Ananas confit Saint-Valentin
» Noix de Saint-Jacques aux poireaux
» Cassoulet aux lentilles
» pour JAJA
» Dakar 2013
» Refrain d'hier
» Poèmes de victor hugo
» Grotte de Lascaux
» TIMBRES FRANÇAIS de 1871
» meilleurs voeux 2013
» Bonne Année 2013
» Bon réveillon a tous
» JOYEUX NÖEL2012
» Décès de Georges Bellec (membre des Frères Jacquesl)
» Farce à chapon
» Panettone de Noël
» Soupe de Saint Jacques et de moules
» décés de Maurice Herzog
» Tour de france 2013
» Bienvenue martine59 et Joséphine140
» Bienvenu CATEX, lionelb, dersim et Obscur
» GP Moto 2012
» Formule1 2012
» Boulettes de veau et salade de pommes de terre
» Pavés dorés à la semoule
» Croquants du midi
» Tajine traditionnel (Maroc)
» Couscous poulet et merguez facile
» Boeuf Bourguignon rapide